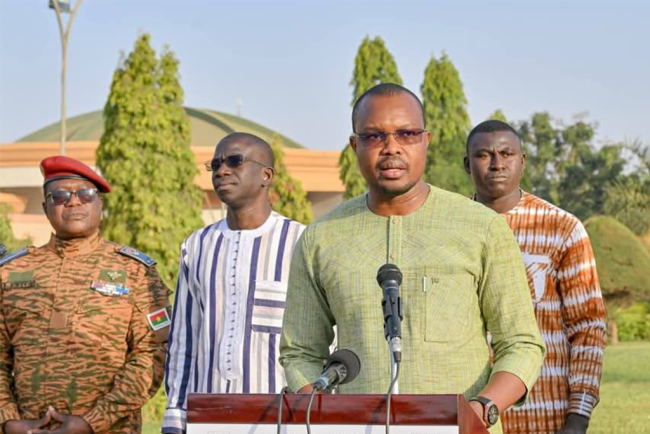Alors que l’Afrique connaît une transformation numérique accélérée, un enjeu fondamental reste largement sous-estimé : la protection des données personnelles. Cet actif invisible, produit massivement par les citoyens, alimente aujourd’hui les algorithmes, les marchés numériques, et les stratégies d’influence. Or, sur l’ensemble du continent, ces données sont encore collectées, stockées et exploitées dans un flou juridique préoccupant, au mépris des droits fondamentaux.
Un vide juridique lourd de conséquences
Certes, des progrès ont été accomplis. Plusieurs pays Nigeria, Afrique du Sud, Sénégal, Kenya, Côte d’Ivoire, entre autres se sont dotés de lois spécifiques, souvent inspirées du Règlement général sur la protection des données (RGPD) européen. Des autorités de contrôle ont été mises en place. Mais à l’échelle continentale, le paysage reste fragmenté, déséquilibré et inopérant.
La Convention de Malabo, adoptée en 2014 pour poser un cadre panafricain, reste sous-ratifiée. Les mécanismes régionaux (CEDEAO, SADC, UMA) manquent d’harmonisation. Résultat : des données circulent sans cadre commun, souvent hors d’Afrique, à la merci d’intérêts privés ou étatiques étrangers.
L’enjeu n’est pas que juridique : il est stratégique
Cette absence de régulation cohérente affaiblit la confiance dans les services numériques, freine la digitalisation des États et expose les citoyens à des abus systématiques. Elle empêche aussi l’Afrique de construire un modèle de souveraineté numérique, dans un monde où les données sont devenues un levier de puissance.
Les grandes puissances l’ont bien compris. L’Europe avec le RGPD. La Chine avec sa loi sur la localisation des données. L’Inde avec sa propre législation sur la vie privée. Chacun pose des règles adaptées à ses intérêts. L’Afrique, elle, reste dans une posture de réactivité, souvent sous influence.
Protéger les données personnelles en Afrique ne peut plus attendre. Il faut une approche continentale coordonnée, fondée sur :
- La reconnaissance de la protection des données comme droit fondamental ;
- Une régulation contraignante des usages publics et commerciaux ;
- La responsabilisation des acteurs privés, y compris les grandes plateformes étrangères ;
- Des autorités nationales réellement indépendantes, dotées de ressources suffisantes.
Le financement de ces structures ne doit pas reposer sur les citoyens ou les PME innovantes, mais sur les grands bénéficiaires de l’économie des données : multinationales, grands opérateurs, plateformes numériques. Il faut aussi créer des fonds régionaux d’appui, mutualisés et solidaires.
Ce combat dépasse les seuls enjeux techniques. Il touche à la dignité humaine, à la justice économique, à l’équité entre les nations. Il engage notre conception du pouvoir et notre capacité à créer un numérique africain fondé sur la confiance, le respect et la responsabilité.
L’Afrique n’a pas besoin de copier les modèles existants. Elle peut inventer le sien, à condition d’y croire collectivement. Il est temps d’ériger la protection des données au rang de priorité politique continentale.
Pierra S.